Tarification sociale de l’eau : des pistes pour lever les freins à sa généralisation
Le choix d’une politique sociale de l’eau doit à la fois être adapté aux problématiques locales, simple pour les usagers et présenter un coût de gestion le plus faible possible pour les collectivités, estime la mission flash de l’Assemblée nationale sur le sujet, qui présentait, ce 23 février, ses recommandations pour permettre un déploiement sur tout le territoire.
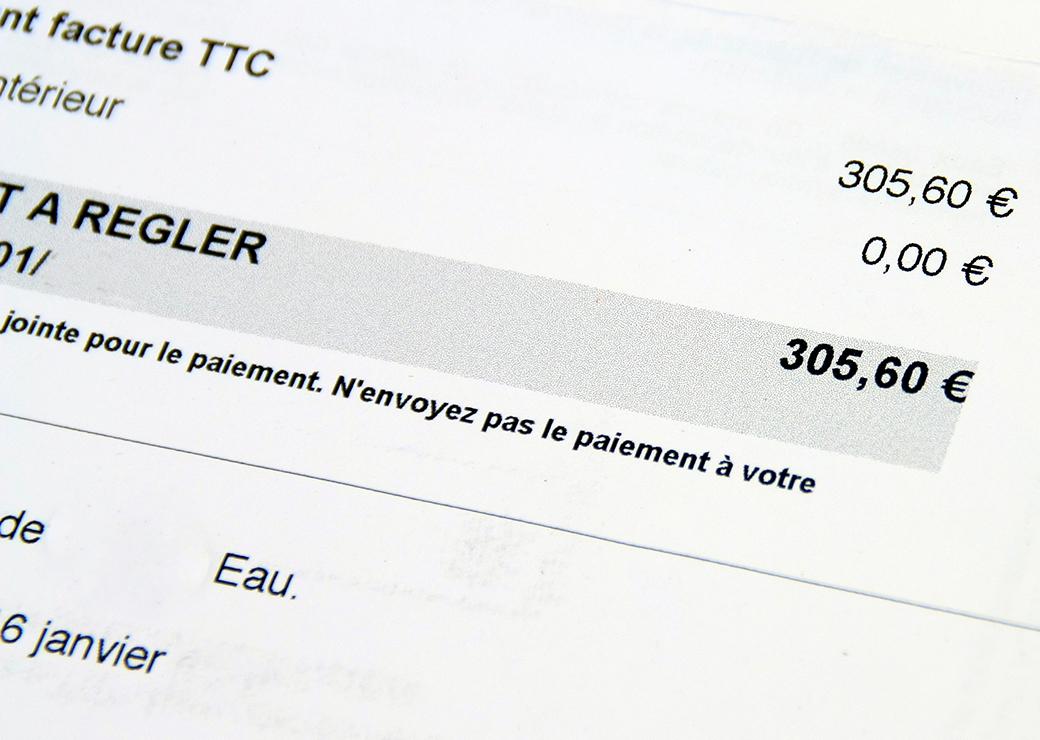
© Adobe stock
La réussite d’une politique sociale de l’eau suppose une volonté politique forte et une ingénierie tarifaire adéquate, conclut la mission flash de l'Assemblée nationale sur ce sujet, qui a présenté ses recommandations ce 23 février, afin d’en accélérer la généralisation sur l’ensemble du territoire. Si les 41 collectivités expérimentatrices (représentant 11 millions de personnes) n’ont pas renoncé aux mesures mises en place dans le cadre de la loi "Brottes" de 2013, les autres ne se sont que rarement emparées de cette possibilité pourtant ouverte depuis 2020 - par la loi Engagement et proximité - à l’ensemble des collectivités chargées du service public d’eau et d’assainissement. Cette politique décentralisée peut paraître complexe à mettre en oeuvre et relativement peu visible, et doit en outre s’articuler avec le défi environnemental, qui suppose un usage raisonné de la ressource, et le souci de maintenir la viabilité économique du service public d’eau et d’assainissement, expliquent les co-rapporteurs, Lionel Causse (Landes/LREM) et Hubert Wulfranc (Seine-Maritime/GDR).
D’importantes disparités territoriales
Si les charges d’eau restent relativement peu élevées en France au regard d’autres biens essentiels comme l’électricité ou l’alimentation, la facture dépasse 3% des revenus pour plus d’un million de foyers, un seuil utilisé comme convention pour identifier les populations confrontées à des difficultés d’accès à l’eau. Premier constat : le sujet est traité de manière très variable selon les territoires. Tout d’abord, de fortes différences du prix de l’eau existent d’une collectivité à l’autre : de 3,66 euros/m3 en Provence-Alpes-Côte d’Azur à 4,80 euros/m3 en Bretagne, pour un prix moyen en France métropolitaine de 4,19 euros/m3, soit une facture de 503 euros/an (42 euros/mois). Et la seule facture d’eau ne suffira d’ailleurs pas à faire face au "mur d’investissement" en matière de renouvellement de leurs réseaux, auquel vont se heurter en particulier les collectivités rurales chargées d’assurer la gestion d’importants linéaires au regard de leurs ressources financières.
Les politiques sociales de l’eau sont donc elles-mêmes le reflet des disparités territoriales et de la variété des choix politiques des collectivités en matière d’accès à l’eau. Une boîte à outils qui comprend outre la tarification sociale au sens strict, c’est-à-dire la modulation des tarifs de la part fixe et/ou variable, et le cas échéant par tranches de volume d’eau consommée, l’attribution d’aides forfaitaires au paiement de la facture d’eau (chèque eau, allocation, fonds de solidarité logement etc.), ou a minima des campagnes de communication, des kits d’économie d’eau.
Des organismes sociaux pas toujours coopératifs
Pour expliquer le faible déploiement du dispositif, la mission pointe différents points de blocage tenant principalement au manque de fluidité dans le transfert des données détenues par les administrations de sécurité sociale pour identifier précisément les foyers bénéficiaires de cette politique sociale de l’eau. Certains organismes sociaux se rangent derrière le règlement général sur la protection des données (RGPD), d’autres évoquent le manque de moyens techniques et humains pour effectuer de tels transferts. Un certain flou qui pourrait néanmoins trouver un dénouement puisqu'un décret est semble-t-il en cours de préparation pour clarifier les conditions et modalités de transmission de données personnelles entre les différents intervenants.
S’y ajoutent des difficultés techniques d’identification des bénéficiaires, notamment dans l’habitat collectif doté de compteurs d’eau non individualisés. De plus, le taux de non recours est particulièrement important en matière d’aides pour l’accès à l’eau, dans la mesure où le montant de l’aide est relativement faible (entre 10 et 150 euros par an) et où les dispositifs sont peu connus des usagers. Les plus fragiles y renoncent parfois au regard de la lourdeur des démarches à effectuer ou de la peur d’être stigmatisés.
Des collectivités hésitantes à se jeter à l’eau
La mise en œuvre d’une politique sociale de l’eau bute par ailleurs sur les coûts de gestion parfois rédhibitoires pour les collectivités. Ainsi la métropole de Rouen Normandie a indiqué qu’une analyse coûts-bénéfices l’avait conduite à renoncer au motif que l’accès aux données financières des abonnés ainsi qu’une étude personnalisée de leur situation engendraient des coûts de fonctionnement élevés comparativement aux montants d’aides perçus. Le syndicat de l’eau du Dunkerquois, qui a de son côté mis en place une tarification sociale aboutie, reconnaît que celle-ci "nécessite une maîtrise d’œuvre conséquente que certaines structures ne peuvent assurer en interne". Pour le syndicat, le coût de gestion annuel du dispositif est de 1,5 centime d’euro par m3 et sa mise en place en 2012 a représenté une dépense de 180.000 euros, illustre la mission.
Des plans d’actions pour améliorer l’accès à l’eau
Pour les co-rapporteurs, la connaissance précise des usages, l’établissement de plans d’actions dans chaque collectivité et la formulation d’un référentiel national pour les mettre en œuvre représentent des prérequis à une généralisation de la politique sociale de l’eau. Les arbitrages en la matière doivent ainsi nécessairement, selon eux, résulter "de la réalité du terrain, qui prenne en compte les caractéristiques socio-économiques de la population, le type d’habitat, le prix des services d’eau et d’assainissement ou encore l’état de la ressource". Des initiatives intéressantes sont déjà en cours dans certains territoires - à l’exemple des échanges d’éléments statistiques entre la CAF de Loire-Atlantique et la métropole de Nantes - pour affiner les indicateurs de précarité hydrique. A l’échelle nationale, la mission recommande de développer une plateforme cartographiant l’ensemble des collectivités engagées dans une politique sociale de l’eau. L’existence d’une grille de lecture, type logigramme, leur permettrait d’identifier les mesures les plus adaptées en fonction des caractéristiques locales. Et un dossier méthodologique préciserait utilement les démarches administratives à effectuer et les moyens à mettre en œuvre dans le dispositif choisi.
La tarification progressive, solution privilégiée
La mission n’y voit que des avantages sur le plan à la fois écologique (en incitant tous les ménages à mieux consommer l’eau en fonction de leurs besoins) et social (grâce à une tarification plus avantageuse pour les personnes précaires). Cette tarification progressive pourrait donc être "privilégiée partout où elle est adaptée", en distinguant trois tranches de prix sur le modèle du syndicat de l’eau du Dunkerquois : une première de 0 à 80 m3 pour "l’eau essentielle", à un coût symbolique, avec un tarif préférentiel pour les foyers en situation de précarité ; une deuxième de 81 à 200 m3 pour "l’eau utile", à un tarif inférieur au coût des services ; une troisième au-delà de 200 m3 pour "l’eau de confort", à un tarif supérieur permettant d’équilibrer le budget du service. Le cas échéant, des aides financières (chèques-eau, allocation, revalorisation du forfait charges des aides au logement…) viendraient en complément, notamment pour les familles nombreuses. Une telle progressivité n’a de sens que si la part fixe de la facture "n’est pas trop élevée", insiste la mission, qui plaide également pour un encadrement "plus strict" du montant des abonnements. Le dispositif choisi "doit être simple pour les usagers, bénéficier au plus grand nombre sans contrainte d’utilisation, et présenter un coût de gestion le plus faible possible", relèvent les rapporteurs. Et pour ce faire, il implique l’accès automatique aux aides financières. Comme l'illustre la métropole de Grenoble, où l’aide de solidarité pour l’eau est directement versée sur le compte bancaire des bénéficiaires sans démarche de leur part. Les coûts de gestion (de 25.000 euros par an) y sont faibles au regard des montants d’aides distribués (plus de 658.000 euros en 2020).
Vers une harmonisation du prix de l'eau
"Un tarif unique de l’eau serait certes difficile à mettre en place compte tenu de la diversité des territoires", reconnaît la mission, tout en jetant un pavé dans la mare. Un premier palier serait de réfléchir à une harmonisation des prix "par bassin de vie", ce que doit permettre le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes, prévu par la loi NOTRe d’août 2015. Dans ces collectivités plus grandes, il paraît envisageable de converger vers des "prix alignés", grâce à la mutualisation des ressources et à des mesures de solidarité entre les territoires.
Bien d’autres leviers sont passés en revue par la mission, qui invite notamment à travers des retours d’expérience positifs, à développer les actions de prévention et de sensibilisation à une consommation raisonnée de l’eau (projet "MAC Eau" en Gironde), à promouvoir les atouts de l’eau du robinet (marque "la Bisontine" à Besançon) ou encore à faire la chasse aux fuites.
Enfin, sur la problématique de l'accès à l’eau des personnes non raccordées, qu’elles soient sans logement ou vivant dans des habitats informels, les rapporteurs soulèvent la "nécessaire clarification des rôles et des compétences" et proposent d’outiller les collectivités de schémas directeurs d’alimentation en eau potable pour répondre à cette question complexe.


