Décarbonation des mobilités : l'Agence France locale appelle à son tour à revoir un modèle de financement "inadapté"
À deux semaines du lancement de la conférence "Ambition France Transports", l'Agence France locale vient de publier une synthèse des défis que doivent relever les autorités organisatrices des mobilités pour contribuer à la décarbonation de ces dernières (ou à la "démobilité"). Y sont listées différentes pistes pour diversifier les sources de financement nécessaires pour enjamber un "mur de dépenses massives", alors que le mode de financement actuel est jugé "inadapté". Nombre d'entre elles seront toutefois difficiles à mettre en œuvre, comme en témoignent les déclarations peu favorables faites ce 18 avril par le ministre des Transports à l'égard de la taxe sur les billets d'avion.
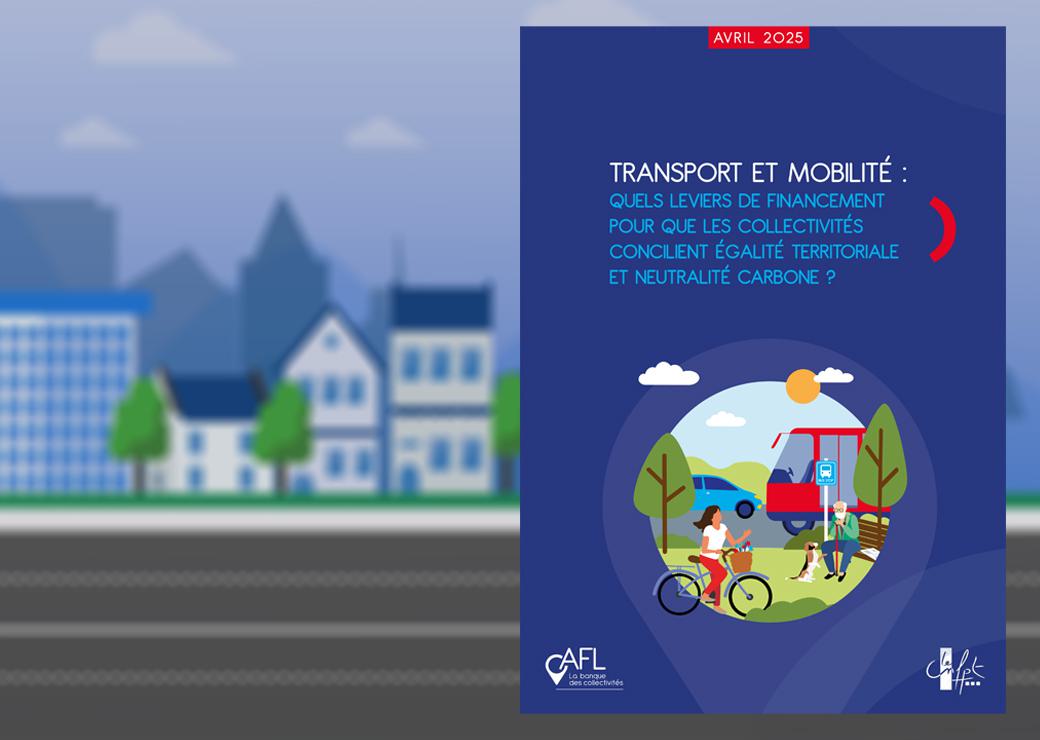
© AFL, CNFPT et Adobe stock
Face au "volume d'investissements à engager pour la décarbonation du secteur des transports", "le recours à l'emprunt paraît être une solution indispensable pour parachever le panier de ressources à la disposition des collectivités", avec "l'élargissement de la fiscalité affectée". Telle est la principale conclusion mise en avant par l'étude "Transport et mobilité : leviers de financement pour que les collectivités concilient égalité territoriale et neutralité carbone" que vient de publier l'établissement de crédit Agence France locale, dont elle avait confié la rédaction à des élèves administrateurs territoriaux et des élèves ingénieurs en chef territoriaux de l'Inet.
Une course d'obstacles dans les zones rurales
De manière générale, l'étude constitue une synthèse des défis que doivent relever, et dispositifs que peuvent déployer, les collectivités – singulièrement les autorités organisatrices des mobilités – afin de contribuer à l'objectif d'une France décarbonée en 2050. Et ce, alors qu'il est rappelé que "le secteur des transports représente près [plus] du tiers de l'empreinte carbone nationale (34%), dont la moitié provient des voitures thermiques". En creux, l'étude démontre notamment, si besoin était, que cette course à la décarbonation se fait particulièrement redoutable pour les zones rurales. D'abord, ces dernières partent de plus loin : "86% des ménages ruraux n'ont pas d'alternative" à la voiture (lire notre article du 26 novembre) – "les services de transport en commun [y] sont rares, voire inexistants" – et "plus de la moitié des habitants doivent parcourir plus de 3 km pour des services de base" (sans doute bien davantage pour consulter un médecin). Ensuite, elles courent avec des boulets au pied : "Les territoires ruraux font face à des contraintes techniques, telles que de longues distances à parcourir, des cars souvent peu remplis, des difficultés de recharge rapide et un retard dans le développement de l'hydrogène, ce qui complique la transition vers des solutions de transport plus durables", observent, entre autres, les auteurs. Enfin, les zones rurales ne bénéficient pas des mêmes "carburants" que leurs "concurrentes" citadines. Ainsi, s'il est observé que "le modèle actuel de financement repose essentiellement sur les entreprises au travers du versement mobilité (VM) et de la prise en charge par l'employeur des frais de transport", l'étude souligne que "le VM concerne peu les territoires ruraux". Logique, puisqu'il "nécessite des services réguliers de transport public pour son application".
Le vieillissement de la population, l'impensé des mobilités ?
Face aux mobilités, "les inégalités spatiales" perdurent donc, voire se renforcent. L'étude relève que c'est par exemple le cas s'agissant de la pratique du vélo : "En milieu rural, la fréquentation diminue." Et les auteurs de pointer ici que "paradoxalement, ce sont ces territoires qui nécessitent les investissements les plus importants, tant en infrastructures qu'en accompagnement au changement, alors que leurs administrés paraissent moins convaincus par les mobilités actives". Un "paradoxe" qui n'est néanmoins qu'apparent quand on sait, par exemple, que la distance médiane domicile-travail est deux fois plus grande pour les actifs résidant dans un territoire rural que pour ceux résidant dans un territoire urbain (lire notre article du 31 mai 2023) et que les déplacements des ruraux sont de manière générale bien plus longs que ceux parcourus par les urbains (lire notre article du 4 septembre 2024). Ou, encore, quand on a conscience que dans les territoires ruraux, près de quatre habitants sur dix étaient âgés de 60 ans ou plus en 2018, selon l'observatoire des territoires. En matière de mobilités, l'enjeu du vieillissement de la population semble d'ailleurs faire plus que jamais figure d'éléphant dans la pièce. Pour preuve, il n'est nullement évoqué dans la présente étude – seul celui des réseaux étant mentionné.
Un "sentiment" d'abandon ?
Ces inégalités spatiales devraient même continuer de s'accentuer. Alors les auteurs de l'étude invitent notamment à "prioriser le développement des transports collectifs entre les zones périurbaines et les zones d'emplois des agglomérations", dans une logique utilitariste qui, économiquement, se conçoit aisément. Au risque toutefois de nourrir un "sentiment d'abandon [qui] se fait déjà sentir", l'étude notant que 51% des ruraux se déclarent "négligés", citant une étude Ifop de 2023. À l'heure de la fronde des auto-proclamés "gueux" contre les ZFE (lire notre article du 4 avril), d'autres préconisations de l'étude risquent d'ailleurs d'aviver ce sentiment, à commencer par l'introduction de péages urbains (ou la réduction de la vitesse des véhicules). Ce d'autant que, comme elle le rappelle, la part du budget consacrée aux transports est déjà plus importante chez les ruraux (21%) que pour les urbains (16%).
Solutions connues, mais douloureuses et pas toujours rentables
L'étude met en outre en relief "l'inadaptation" du modèle actuel de financement, et liste différentes solutions, globalement connues, pour y remédier. Parmi les moins classiques, on signalera la "mise sur pied d'une assiette universelle pour harmonier le rendement du VM" ou celle visant à mettre à contribution les hôtes des plateformes de location à ce même VM. Plutôt qu'une improbable panacée, un "panier de ressources" foncièrement garni apparaît plus que jamais incontournable. Vu le contexte économique et budgétaire, nombre de ces pistes paraissent en effet plus proches du sentier que de la 2X2 voies, et sont à tout le moins difficiles à mettre en place, voire à maintenir. Ainsi, par exemple, de la taxe sur les billets d'avion. Ce 18 avril sur Europe 1, le ministre des Transports a une nouvelle fois exprimé ses réserves sur cette dernière : "À titre personnel, je ne souhaite pas que cette taxe puisse être reconduite dans les mêmes conditions que l'année dernière. […] Avant de la reconduire, il faudra je pense y réfléchir à deux fois." Philippe Tabarot précise qu'il est "en train de faire analyser les conséquences de cette taxe", notamment "sur certains aéroports, sur certaines compagnies, qui risquent de ne pas rester en France, et puis également au niveau touristique. On s'aperçoit depuis quelques jours que cette taxe a pu faire que des personnes qui souhaitaient venir en France ont choisi d'autres destinations dites concurrentes". Il attend ces analyses "dans les jours qui viennent", a-t-il précisé, estimant d'ores et déjà que "le produit espéré, qui était d'1 milliard [d'euros], n'est pas au rendez-vous". Nul doute que les débats de la prochaine conférence "Ambition France Transports" (lire notre article du 16 avril) ne manqueront pas d'être vifs.


