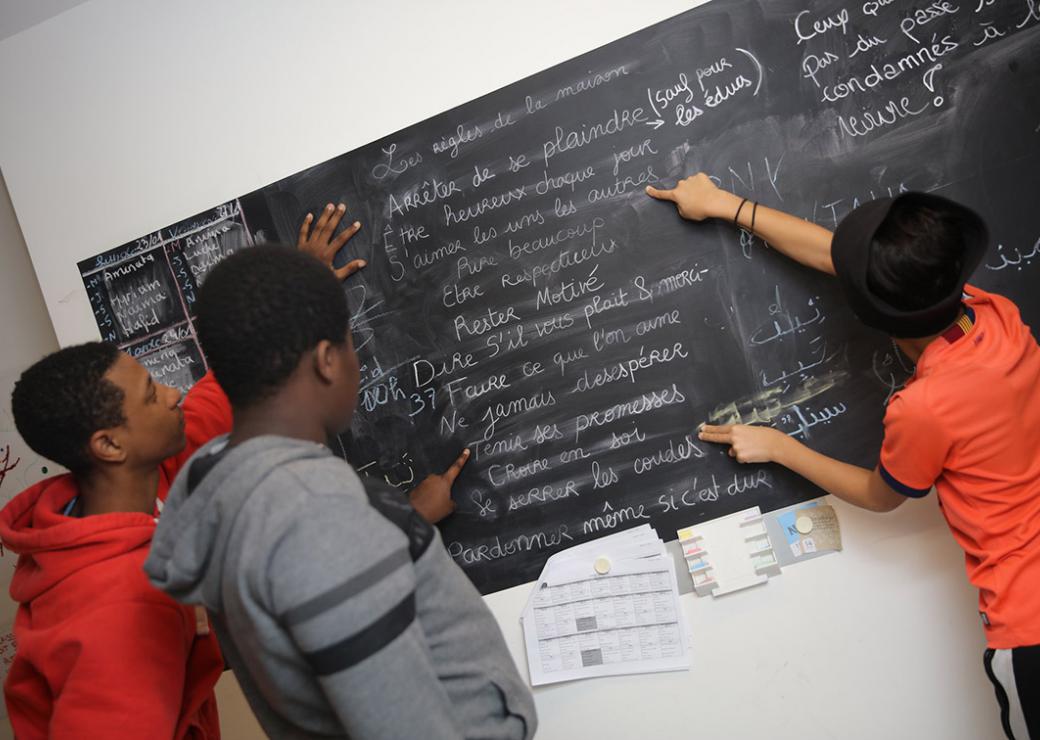Enfance : malgré de fortes différences locales, l'ASE a plutôt bien résisté pendant la crise sanitaire
Une enquête flash de la Drees demandée par Adrien Taquet livre un état des lieux du fonctionnement des établissements et services de l'Aide sociale à l'enfance durant le confinement. Malgré des conditions loin d'être idéales (masques, isolement, baisse des personnels...), le fonctionnement a été globalement préservé avec, toutefois, des situations locales très diverses. Dans le même temps, la Commission nationale consultative des droits de l'homme publie de son côté un avis très critique sur "Le respect de la vie privée et familiale en protection de l'enfance".
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) des ministères sociaux publie les résultats d'une enquête flash sur "Les établissements et services de l'aide sociale à l'enfance pendant la période de confinement liée au Covid-19", réalisée à la demande du secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance. Dans un communiqué, Adrien Taquet "tient à saluer la mobilisation des professionnels, dont l'enquête de la Drees montre la mobilisation en termes de temps de travail pour répondre à la situation de crise". Mais, dans le même temps, la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'homme) publie un avis beaucoup plus critique, pour ne pas dire antagoniste, sur "Le respect de la vie privée et familiale en protection de l'enfance : un droit fondamental difficilement assuré dans un dispositif en souffrance" (voir notre encadré ci-dessous).
Un état des lieux durant la troisième semaine de confinement
L'enquête flash de la Drees prend la forme d'un état des lieux durant la troisième semaine de confinement (du 30 mars au 5 avril 2020). Elle couvre plusieurs catégories d'établissements ou services d'action éducative de l'ASE (associatifs ou internes aux départements) : maisons d'enfants à caractère social (Mecs), foyers de l'enfance, pouponnières, villages d'enfants, lieux de vie, services d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) et services d'action éducative à domicile (AED). Au final, 33% des 2.097 établissements et 20% des 352 services d'action éducative sollicités ont répondu à l'enquête, qui couvre 85 départements (les départements ne réalisant pas d'action éducative en interne n'ayant pas été intégrés).
En termes sanitaires, les résultats montrent qu'à la date de l'enquête, seuls 0,5% des jeunes étaient atteints par le covid-19 (cas suspectés ou avérés). Ce taux monte à 3,5% pour les personnels. Et cela malgré des conditions qui semblent loin d'être idéales. Seuls 57% des établissements de l'ASE offraient ainsi à leur personnel la possibilité de se laver et de se changer sur leur lieu de travail, ce qui est totalement impossible dans un quart d'entre eux. A la date du 5 avril, seuls 45% des établissements disposaient de masques pour l'ensemble du personnel et des bénévoles en contact avec des enfants non malades du covid-19. Mais un tiers des structures ne disposaient d'aucun masque à cette date. Enfin, deux établissements sur cinq disent avoir eu la possibilité de confiner individuellement l'ensemble des jeunes malades (suspectés ou avérés) du covid-19 et de les isoler du reste du groupe. A l'inverse, près d'un sur cinq (16%) n'a pas eu cette possibilité pour des raisons de configuration des lieux.
Un fonctionnement globalement préservé, sauf pour le droit de visite
En termes de fonctionnement, deux établissements de l'ASE sur trois et la moitié des services d'action éducative ont connu une baisse de leurs effectifs de personnel par rapport à la situation antérieure au confinement. Parmi les raisons de cette baisse, 75% des établissements concernés et 85% des services évoquent des problèmes de garde d'enfants. L'exercice du droit au retrait par les personnels n'a en revanche joué qu'un rôle "extrêmement secondaire" dans ces baisses d'effectifs. Conséquence de ces réductions de moyens humains : trois établissements de l'ASE sur cinq et deux services d'action éducative sur cinq indiquent que le personnel présent a dû travailler davantage qu'en temps normal.
Cette situation explique sans doute, au moins pour partie, le fait qu'au cours de la semaine du 30 mars au 5 avril, des jeunes ont dû quitter leur lieu de vie habituel (lieux d'accueil ou milieu familial) dans 25% des établissements de l'ASE et dans 30% des services d'action éducative. L'objectif principal affiché de ces changements de lieu était toutefois la volonté de "privilégier un retour des jeunes en famille pendant le confinement". A l'inverse, durant la semaine étudiée, un établissement sur cinq et la moitié des services d'action éducative ont continué d'admettre de nouveaux jeunes au sein de leur structure.
Par ailleurs, quatre établissements sur cinq indiquent n'avoir pu maintenir le droit de visite et d'hébergement des parents pour les jeunes placés. La proportion est la même dans le cadre des suivis éducatifs à domicile ou en milieu ouvert, mais pour seulement une petite partie des enfants concernés.
"Une hétérogénéité des situations locales"
L'enquête de la Drees met aussi en évidence les difficultés liées à l'environnement des établissements et services de l'ASE. Si 98% d'entre eux ont été en mesure d'assurer le suivi et le soutien scolaire d'au moins une partie des jeunes scolarisés – le plus souvent (83%) pour l'ensemble ou pour une grande majorité des jeunes –, il n'en va pas de même pour la continuité des suivis et des soins médico-psychologiques. En effet, un quart des établissements n'ont pas pu les assurer.
Dans son communiqué, Adrien Taquet indique que "l'enquête montre également une hétérogénéité des situations locales, qui doit conduire à poursuivre le travail d'analyse de la situation afin de tirer tous les enseignements nécessaires". Le secrétaire d'État a d'ores et déjà saisi le GIP Enfance en Danger (Giped) – qui coiffe l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE) –, "afin d'obtenir dans les prochaines semaines un retour d'expérience complet sur le fonctionnement du système de protection de l'enfance durant la crise".
La CNCDH pointe les dysfonctionnements et veut "repenser la protection de l'enfance"Alors que paraissent les résultats de l'enquête flash de la Drees, la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'homme) publie un avis intitulé "Le respect de la vie privée et familiale en protection de l'enfance : un droit fondamental difficilement assuré dans un dispositif en souffrance". La vision qui en émane est nettement moins positive. L'avis n'est toutefois pas en lien direct avec la pandémie de covid-19, puisqu'il résulte d'une saisine par le secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance remontant à octobre 2019. La CNCDH, qui se dit "préoccupée depuis plusieurs années par le fonctionnement de la protection de l'enfance", estime que "bien que l'intérêt de l'enfant soit désormais placé au cœur de la protection de l'enfance, [...] de nombreux dysfonctionnements persistent". L'avis cite notamment l'insuffisance de la formation des acteurs aux règles juridiques applicables, des délais trop longs pour l'exécution des décisions de justice, des pratiques "très hétérogènes selon les départements", les insuffisances dans le suivi et la coordination entre les acteurs, l'absence de véritables référents stables ou encore le manque de moyens. Outre un renforcement des moyens humains et matériels, la CNCDH recommande rien moins que de "repenser le fonctionnement de la protection de l'enfance". Elle formule à ce titre une trentaine de préconisations. Parmi celles-ci, on peut notamment citer la réalisation de comptes rendus précis des réunions de concertation lors des décisions initiales ou des révisions des mesures, la mise en place d'une "formation juridique approfondie" pour tous les intervenants, la clarification des modalités d'exercice de l'autorité parentale (en particulier sur la distinction entre les actes usuels et non usuels), ou encore une clarification des textes et des pratiques relatifs à la délégation et au délaissement parental. Dans le même esprit, l'avis recommande de clarifier la notion de statut de l'enfant confié. La CNCDH préconise aussi de "mettre en place une véritable politique de prévention, graduelle et transversale, via notamment le développement de dispositifs de répit ou encore de relais parental, mais également des centres parentaux destinés à protéger les premiers liens d'attachement du bébé et la confirmation de ses parents comme premiers acteurs de la protection de leur enfant". En parallèle, il conviendrait de mettre en place une "aide appropriée" au profit des parents. Parmi les autres mesures suggérées, on retiendra également la mise en place d'une politique volontariste en faveur des fratries, un recours moins formel aux aidants, un renforcement du rôle de l'administrateur ad hoc, mais aussi un vrai respect de la vie privée de l'enfant protégé, par exemple avec le respect de la correspondance ou la création d'un espace numérique protégé pour chaque enfant. |