Fraude sociale : encore un rapport, mais des propositions intéressantes sur la fraude au RSA
C'est au tour de l'Assemblée nationale de publier un rapport d'enquête "relatif à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales". Avec des propositions très concrètes, notamment concernant le RSA : étendre au RSA la mise en place du dispositif de ressources mutualisées (DRM), "confier aux caisses de la branche famille le pouvoir de sanctionner sur tout le territoire les fraudes au RSA qu'elles détectent"...
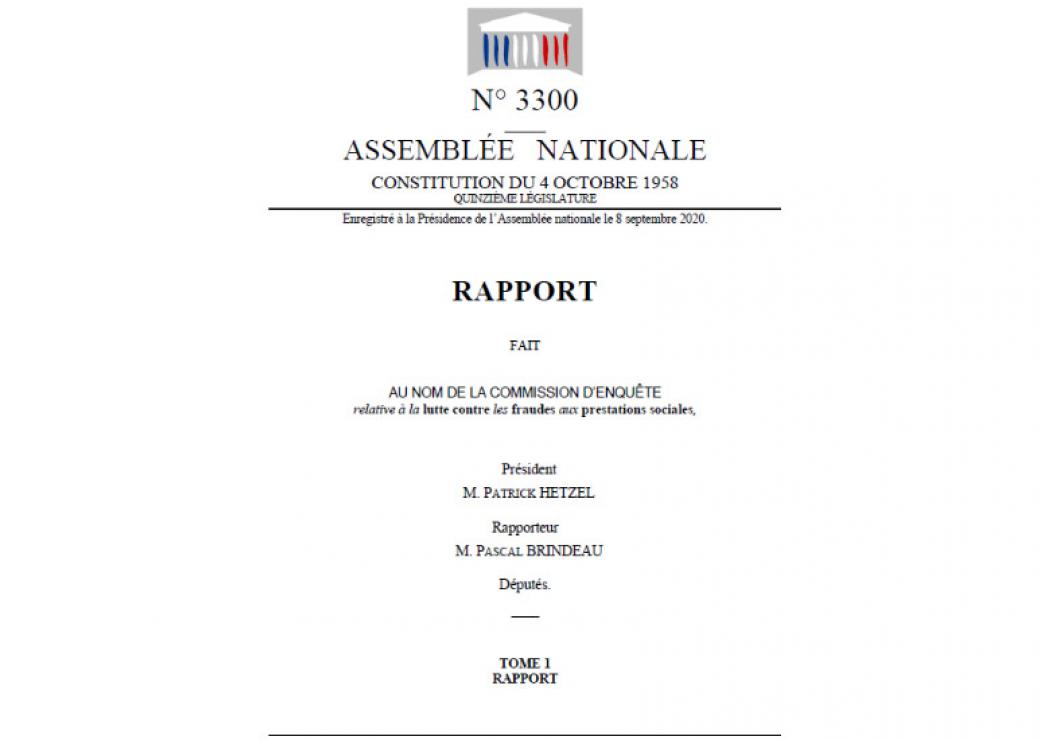
© Assemblée nationale
La fraude aux prestations sociales est décidément un sujet inépuisable de rapports, mais aussi de polémiques. Quelques jours après celui-de la Cour des comptes (voir notre article du 10 septembre 2020) – qui, commandé par le Sénat, a donné lieu, dans la foulée, à un rapport d'information du rapporteur général de la commission des affaires sociales, Jean-Marie Vanlerenberghe –, c'est au tour de l'Assemblée nationale de publier un rapport d'enquête "relatif à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales". Celui-ci est présenté par Pascal Brindeau, député (UDI et Indépendants) du Loir-et-Cher, tandis que la commission d'enquête était présidée par Patrick Hetzel, député (LR) du Bas-Rhin.
La face cachée de la simplification
Très complet, ce rapport ne s'attarde pas – contrairement à celui de la Cour des comptes – sur la question insoluble de l'estimation du volume de la fraude sociale. Il préfère se concentrer sur les solutions opérationnelles susceptibles de l'endiguer, en ciblant les principaux risques : fraude documentaire (falsification de documents), fraude à l'identité, failles du dispositif d'immatriculation à l'étranger, mais aussi fraudes en bande organisée "qui alimentent les organisations criminelles et terroristes".
Sur ces différents points, le rapport fait des propositions très concrètes. Il met aussi le doigt sur un certain nombre de sujets rarement évoqués. Il montre ainsi, par exemple, comment la simplification – mise en œuvre par les organismes de protection sociale et par les gouvernements successifs – peut parfois être source de fraude ou, à tout le moins, la favoriser. C'est le cas notamment de la dématérialisation des documents. Comme l'a expliqué à la commission d'enquête le directeur de la police aux frontières : "Clairement, la dématérialisation facilite la fraude. Il est, en effet, très compliqué de détecter un faux document sur un écran. La détection est alors davantage liée à un contrôle de cohérence, de pertinence qu'au support lui-même." C'est aussi le cas de la transformation du numéro d'identifiant d'attente (NIA) en NIR (numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, appelé communément le numéro de sécurité sociale). En effet, dans un souci de simplification et pour faire face à certaines situations complexes, "plusieurs cas permettent la transformation d'un NIA en NIR sans que l'ensemble des pièces aient pu être produites".
Étendre au RSA le dispositif de ressources mutualisées
Comme tous les précédents rapports sur le sujet, celui de la commission d'enquête de l'Assemblée constate que la prestation la plus fraudée – et aussi celle donne lieu au plus grand nombre d'indus, à ne pas confondre avec les fraudes – est le RSA (15.477 cas de fraude détectés en 2019, soit 44% de la fraude détectée au sein de la branche famille), suivi par les aides personnelles au logement et la prime d'activité. Mais, contrairement aux autres rapports, celui de la commission d'enquête de l'Assemblée va plus loin sur la fraude au RSA et propose un certain nombre de solutions.
Ainsi, il préconise d'étendre rapidement au RSA la mise en place du dispositif de ressources mutualisées (DRM), déjà engagée dans le cadre de la réforme des aides au logement. Le DRM présente en effet l'avantage d'être alimenté, de manière automatisée et dématérialisée, par deux bases de données. D'une part, la base alimentée par les données de salaires déclarés par les employeurs du secteur privé via les déclarations sociales nominatives (DSN) et qui est déjà utilisée pour l'application de la retenue à source de l'impôt sur le revenu. D'autre part, la base Pasrau – également mise en place pour l'application de la retenue à la source –, qui enregistre les autres données de revenus liés à une activité non salariée ou salariée, les données de revenus de remplacement et celles de revenus du capital, alimentées selon le cas par la DGFiP ou par les organismes de protection sociale. Reprenant sur ce point une préconisation de la Cour des comptes, le rapport propose donc d'utiliser le DRM "pour attribuer et calculer les prestations versées par la branche famille, en particulier la prime d'activité et le RSA".
CAF et départements : qui contrôle sanctionne
Mais la détection des fraudes ne suffit pas. Il faut également garantir l'effectivité des sanctions. Or celle-ci se heurte à un certain nombre de difficultés. C'est le cas, par exemple, de la différence dans les délais de prescriptions légaux : cinq ans pour toutes les prestations gérées par la sécurité sociale (maladie, famille et vieillesse), mais deux ans pour le RSA (comme pour l'assurance chômage).
La principale difficulté réside toutefois dans le partage de compétences entre les CAF et les départements. Le rapport rappelle en effet que "la branche famille sanctionne toutes les fraudes qualifiées, à l'exception des fraudes au RSA qu'elle notifie aux conseils départementaux qui ne lui ont pas délégué le pouvoir de sanctionner les fraudeurs. Or, la majorité des conseils départementaux, en l'occurrence 59 sur 101, applique leur propre politique de sanction aux fraudes au RSA".
Cette absence de délégation de pouvoir à la branche famille soulève plusieurs problèmes : traitement différencié d'un département à l'autre (la fraude pouvant alors ne pas être sanctionnée ou, au contraire, être sanctionnée plus durement que le barème national de la Cnaf), obligation d'une concertation entre la CAF et le département et donc allongement des délais lorsque la fraude est "mixte" (portant à la fois sur le RSA et une autre prestation de la CAF), absence d'information des CAF sur les suites données par les départements à leurs signalements...
Pour la commission d'enquête, "cette situation engendre [...] une complexité inutile et même préjudiciable pour les finances publiques". De son côté, lors de son audition, le directeur général de la Cnaf a estimé "qu'une plus grande unité d'action serait opportune pour des raisons d'égalité devant la loi. Elle doit néanmoins se concilier avec le rôle de la collectivité départementale en matière de financement du RSA et avec le principe de libre administration des collectivités territoriales". Le rapport propose donc de "confier aux caisses de la branche famille le pouvoir de sanctionner sur tout le territoire les fraudes au RSA qu'elles détectent, dans l'objectif d'harmoniser la répression de la fraude". A contrario, les départements conserveraient le pouvoir de sanctionner eux-mêmes les fraudes qu'ils détectent. Il resterait toutefois à régler la question de l'harmonisation des sanctions entre CAF et départements, que n'évoque pas le rapport.


