Réduction des déchets : la loi Agec de 2020 a raté sa cible, regrettent des ONG
Quatre ans après sa promulgation, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) a manqué son objectif de réduction des déchets malgré son ambition initiale, déplorent les associations Zero Waste France, France Nature Environnement (FNE), No Plastic In My Sea, Les Amis de la Terre France et Surfrider Foundation Europe. Ces ONG, qui avaient défendu ardemment plusieurs mesures reprises dans la loi, jugent l'application du texte décevante du fait de décrets ayant réduit sa portée. Elles formulent dix recommandations pour rectifier le tir et vont même jusqu'à réclamer une deuxième loi sur l'économie circulaire, "plus précise" avec des objectifs concrets de réduction des emballages et des "contraintes plus fortes".
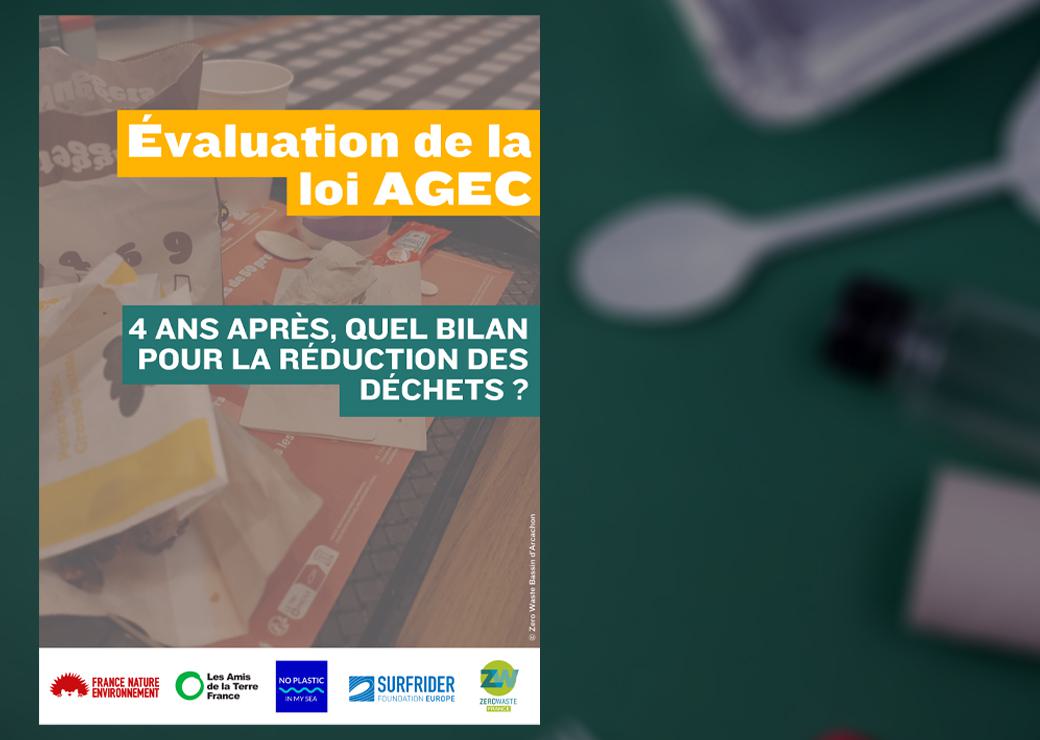
© France nature environnement, Les Amis de la Terre France, No plastic in my sea, Surfrider et Zero waste
À quelques jours du quatrième anniversaire de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), cinq associations qui avaient défendu les mesures de réduction des déchets inscrites dans le texte - Zero Waste France, France Nature Environnement (FNE), No Plastic In My Sea, Les Amis de la Terre France et Surfrider Foundation Europe – dressent aujourd'hui un bilan amer de leur application, dans un rapport présenté ce 6 février.
Initialement jugée ambitieuse, tant sur la fin du plastique à usage unique en 2040 que sur le mieux-produire ou l'information du consommateur, la loi peine à livrer les résultats escomptés, estime ce document. De fait, la marche est haute : alors que la loi fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés en 2030 par rapport à 2010, les déchets ont jusqu'ici augmenté, de 590 kg/habitant en 2010 à 611 en 2021 selon l'Ademe.
Lobbying des industriels
"La croissance sans fin de notre production de déchets est un symptôme frappant de l’échec de la loi Agec", analyse Charlotte Soulary, responsable du plaidoyer de Zero Waste France. Les ONG dénoncent un lobbying intense des industriels qui contribue à "détricoter" la loi, le manque de contrôles et de sanctions, et des moyens insuffisants. "Faute de volonté politique pour garantir l’application de la loi, les entreprises ont eu toute latitude pour contourner, voire détourner allègrement le texte de son objectif initial : réduire les déchets et le gaspillage de ressources naturelles", regrette-t-elle.
Illustration, un décret d'application adopté mi-2023 prévoit 29 exemptions à l'interdiction d'emballage plastique pour les fruits et légumes. Les ONG en contestent le bien-fondé pour nombre de légumes (carottes, champignons, endives, pommes de terre), estimant que le risque de détérioration sans emballage n’est pas avéré.
Contrôles jugés insuffisants
"On constate un réel décalage entre ce qui a été annoncé dans la loi et la réalité de l’application des interdictions, précise Axèle Gibert, coordinatrice du réseau prévention des déchets chez France Nature Environnement (FNE). On retrouve encore de nombreux produits en plastique à usage unique interdits dans les commerces, les espaces de restauration ou encore la vente en ligne." "On constate que la loi est aussi détournée par les industriels pour s’affranchir des interdictions", poursuit-elle estimant qu'il est "impératif de sanctionner les acteurs économiques qui ne respectent pas ou contournent la loi". Mais le rapport pointe aussi l'insuffisance des contrôles et sanctions faute de moyens suffisants - la direction de la répression des fraudes (DGCCRF) a ainsi perdu 911 agents en 15 ans.
Le volet de la loi Agec consacré à l'obsolescence programmée n'a pas non plus répondu aux attentes des ONG. Les fonds réparation, qui financent les bonus réparation, ont également été revus à la baisse, notamment sous la pression de la filière des équipements électriques et électroniques, estiment-elles, ce qui n'incite pas les consommateurs à opter pour la réparation.
Poursuite de la hausse des bouteilles en plastique
Le non-respect de certaines mesures phares de la loi Agec, comme l’obligation de vaisselle réemployable pour la restauration sur place, ou d’installation de points d’eau dans les établissements recevant du public (ERP), est également vu comme "un problème récurrent". Pour Muriel Papin, déléguée générale de l’association No Plastic In My Sea, ce sont ainsi "des jalons majeurs de la loi" qui sont remis en cause, et notamment la réduction de 50% des bouteilles plastiques en 2030". Selon les associations, seul un quart des établissements recevant du public a mis en place un dispositif de distribution gratuite d'eau tandis que l'Ademe a constaté une hausse de 4% du nombre de bouteilles mises sur le marché entre 2021 à 2022. Constat similaire pour la fin de la vaisselle réutilisable dans les restaurants d'au moins 20 couverts : fin 2023, environ la moitié d'entre eux se conformaient à la loi, selon une enquête de l'UFC-Que Choisir.
Les ONG pointent quelques avancées seulement : la généralisation des éco-cups dans les festivals, la suppression des pailles en plastique et des gobelets en polystyrène expansé.
Pénaliser les pratiques de surproduction
La loi n'est pas parvenue "à impulser un changement de paradigme en faveur d'une société plus sobre", notent les associations. Elle n’a pas permis, par exemple, de généraliser le réemploi des emballages, ni de concrétiser l’interdiction de destruction des invendus, ou encore d’assurer une certaine transparence vis-à-vis des consommateurs quant à l’impact environnemental des produits, regrettent-elles. "Surtout, le texte ne contraint pas les différentes filières de production à s’engager sur une trajectoire de réduction des biens mis sur le marché", soulignent-elles.
"On fait face à une abondance croissante de produits neufs, produits en masse et à bas coûts là où la loi Agec se cantonne à améliorer à la marge la manière dont nous gérons nos déchets", constate Pierre Condamine, chargé de surproduction aux Amis de la Terre France. "La loi s’était fixé l’objectif d’améliorer la production, or mieux produire aujourd’hui c’est surtout moins produire. En accord avec l’objectif des 1,5°C défini par l’Accord de Paris, nous appelons à l’adoption urgente de trajectoires de réduction des biens mis en marché, ainsi que d’outils pénalisant des pratiques de surproduction telles que le suremballage ou la fast-fashion."
Les associations demandent in fine au gouvernement de "passer à la vitesse supérieure pour garantir la pleine application de la loi Agec et ainsi véritablement réduire les déchets et le gaspillage à la source". Outre dix recommandations pour faire respecter la loi et la compléter (lire notre encadré), elles appellent à l’adoption d’une nouvelle loi pour préciser les dispositions existantes et introduire des "contraintes plus fortes".
- Renforcer les effectifs des services de l’État dont la DGCCRF et les Dreal pour contrôler l’application de la loi et sanctionner les acteurs qui ne respectent pas ou contournent la loi. |


