Implantation des panneaux solaires : une instruction fait toute la lumière sur le rôle des architectes des Bâtiments de France
A travers la "doctrine nationale" diffusée par la voie d’une instruction interministérielle, le gouvernement souhaite concourir à l'aide à la décision et faciliter les missions quotidiennes des services patrimoniaux, et notamment des architectes des Bâtiments de France, dans le traitement des demandes d'autorisation d'implantation de panneaux solaires. L’objectif étant in fine d’en permettre le déploiement sur l’ensemble du territoire en bousculant si nécessaire les positions dogmatiques.
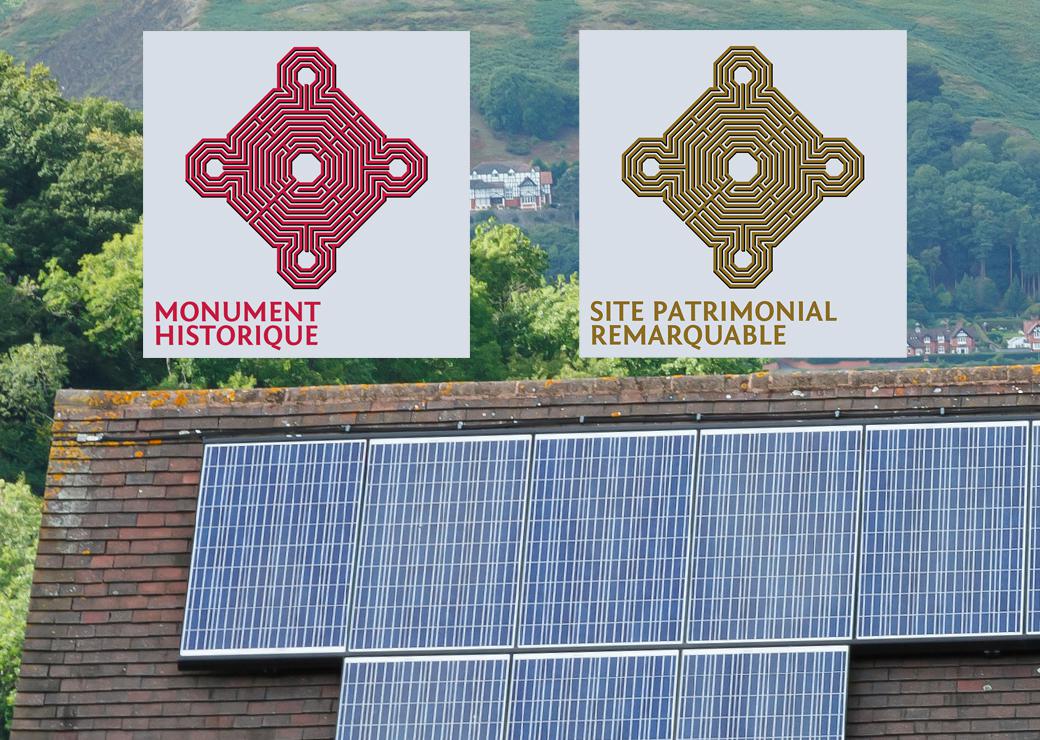
© Ministère de la culture et Adobe stock
Une instruction signée de la main de trois ministres (Culture, Transition écologique et Transition énergétique) fournit des préconisations précises relatives aux demandes d'autorisation d'implantation de panneaux solaires dans le patrimoine protégé. Son objet est ce faisant de "contribuer au développement de l'énergie photovoltaïque en garantissant la préservation du patrimoine, en apportant une meilleure prévisibilité aux porteurs de projets dans l'instruction de leurs demandes d'autorisation et en assurant une instruction cohérente des demandes sur l'ensemble du territoire".
La FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) s’y était déjà employée, il y a quelques temps, en publiant un guide intitulé "Solaire et patrimoine protégé" mais le contexte a évolué depuis. Dans la continuité de la loi Climat et Résilience, le plan d’actions du gouvernement, présenté l’an passé, prévoit ainsi une batterie de mesures pour l’essor des projets photovoltaïques (20,1 GW en 2023, puis 44 GW pour 2028 et 100 GW en 2050), en ciblant en priorité les zones déjà artificialisées. Et le projet de loi d’accélération de la production d'énergies renouvelables, en cours d’examen, devrait venir le conforter en la matière sur plusieurs points, tels que les parkings extérieurs (dispositifs d'ombrières), notamment ceux de plus de 1.500 m2, les délaissés routiers et autoroutiers ou les terrains dégradés. Concilier développement des énergies renouvelables et préservation du patrimoine et des paysages, ce sujet de "sensibilité particulière et d’acceptabilité sociale", souligne l’instruction, est précisément l'un des points de crispation du projet de loi.
Le gouvernent a finalement accepté de maintenir l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France (ABF) pour lancer les projets d'énergies renouvelables dans les zones patrimoniales, tout en leur demandant via la présente instruction - signée le 9 décembre et rendue publique le 13 janvier - d’être plus ouverts en la matière. Pour parvenir à cet équilibre, il mise sur "la qualité de la relation instaurée entre les services de l'État, notamment les ABF et les porteurs de projets", et espère ainsi éviter les situations de blocage voire anticiper les éventuels recours. La mission d'accompagnement de l'ABF, qui permet aux porteurs de projets d'améliorer leurs propositions, constitue entre autres l'un des axes de la stratégie déployée au ministère de la Culture depuis 2018, rappelle le document, qui prône plus généralement "l’enrichissement et l'harmonisation des conseils dispensés aux porteurs de projets".
Prescriptions pour les sites protégés et appel à la souplesse
Pour les bâtiments construits après 1948 (non protégés au titre des monuments historiques), un accueil favorable doit être réservé par principe à l’implantation de panneaux solaires sur toitures, précise l'instruction, tout "en veillant à leur bonne intégration architecturale et paysagère". Un refus ne doit leur être opposé "que s'ils portent atteinte à l'architecture de bâtiments remarquables (labélisés ou non), au paysage, ou dans les cas où l'implantation de panneaux solaires serait proscrite par le règlement du site patrimonial remarquable (règlement du PSMV, du PVAP, de la ZPPAUP ou de l’AVAP)", détaille-t-elle.
Sur les bâtiments anciens cette fois (construits avant 1948), et s’agissant des sites patrimoniaux remarquables et abords de monuments historiques, le principe est également de donner une issue favorable aux projets de panneaux solaires, sous réserve de leur compatibilité avec la conservation et la mise en valeur du patrimoine et du paysage, et s'ils ne sont pas proscrits par le règlement du site patrimonial remarquable. Le cas échéant, ces projets pourront faire l'objet "de prescriptions pour garantir leur bonne intégration architecturale et paysagère".
Les préfets devront par ailleurs veiller à ce que l'implantation des panneaux solaires "soit prévue et encadrée dans les nouveaux règlements des sites patrimoniaux remarquables" : plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP), lors de leur élaboration ou de leur révision.
La position est nettement plus stricte concernant les monuments historiques classés ou inscrits sur lesquels l’implantation de panneaux solaires (au sol ou en toiture) est "de manière générale, à éviter", indique l’instruction. Toutefois, là encore, le gouvernement appelle les services patrimoniaux à faire preuve de souplesse au regard notamment d’avancées techniques, comme les tuiles solaires, qui peuvent s'intégrer au bâti de façon harmonieuse. Des exceptions sont donc "possibles", justifiées par exemple par le caractère discret du lieu d'implantation ou par la nature technique des bâtiments considérés.
Le cas des immeubles labélisés "architecture contemporaine remarquable", des sites classés et inscrits au titre du code de l’environnement ou des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial est également brièvement évoqué.
Un guide des bonnes pratiques en préparation
La consultation des ABF n'est pas prévue en dehors des espaces protégés au titre du code du patrimoine ou du code de l'environnement. L’instruction invite néanmoins "à diffuser les ‘bonnes pratiques’ en matière d'implantation de panneaux solaires, notamment auprès des autorités compétentes en matière de PLU et d'autorisation de travaux, pour favoriser la cohérence des règlements d'urbanisme et des modalités d'instruction des projets dans ce domaine".
Un guide national devrait suivre, "dans les prochains mois", pour proposer une synthèse de ces bonnes pratiques.


