Zéro artificialisation nette : les outils fiscaux au coeur d’un nouveau rapport parlementaire
Après le vote au Sénat de la proposition de loi d’assouplissements dite "Trace" - pour trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux -, la contre- offensive de l’Assemblée nationale ne s'est pas fait attendre. Les députées Sandrine Le Feur (EPR-Finistère) et Constance de Pélichy (Liot-Loiret) ont remis, ce 9 avril, leurs travaux à la commission du développement durable, plaidant pour tenir bon sur les objectifs fixés, moyennant un meilleur accompagnement des élus locaux par des outils fiscaux.
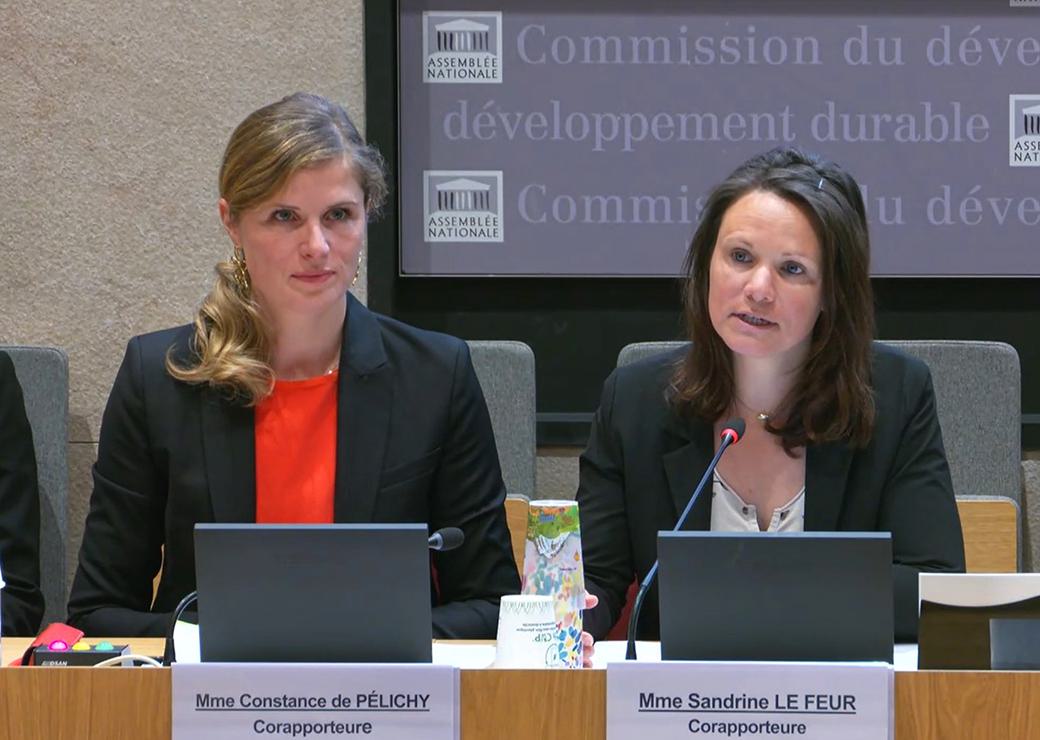
© Capture vidéo Assemblée nationale/ Constance de Pélichy et Sandrine Le Feur
Adopté à l’unanimité, ce 9 avril, par la commission du développement durable, le rapport de la mission d’information sur l’articulation des politiques publiques ayant un impact sur la lutte contre l’artificialisation des sols, confié à Sandrine Le Feur (EPR-Finistère) et Constance de Pélichy (Liot-Loiret), sous la présidence de Marcellin Nadeau (GDR-Martinique), était très attendu alors que le Sénat vient de donner son feu vert à un deuxième round d’assouplissements sur la mise en oeuvre de l'objectif de "zéro artificialisation nette" (ZAN) à horizon 2050.
"Entre la proposition de loi Trace [lire notre article] et les amendements au projet de loi Simplification de la vie économique [lire notre autre article], il est important que notre commission apporte un éclairage réfléchi, appuyé sur des travaux approfondis", a d’emblée souligné la présidente de la commission et corapporteure, Sandrine Le Feur, qui n’a pas caché ces dernières semaines son opposition à ce texte d’initiative sénatoriale qui "détricote" la loi Climat et Résilience. "Nous avons voulu que ce rapport soit utile, qu’il apporte des solutions concrètes aux élus confrontés à la complexité des normes, à la pression foncière et à la nécessaire transformation de leur modèle", a-t-elle relevé.
Une trentaine de "propositions opérationnelles"
Maintenir les objectifs fixés, tout en formulant des "propositions opérationnelles" - une trentaine au total - pour répondre aux "préoccupations légitimes des élus locaux", telle est donc la ligne directrice suivie par la mission. "Le un pas en avant, deux pas en arrière, finalement on y retourne mais en fait on ne sait pas où l’on va, c’est clairement la pire des politiques que l’on est en train de mener. On y va et on y va bien et on se donne les moyens d’y aller ! C’est notre parti pris dans le rapport", a appuyé Constance de Pélichy, insistant sur les retours unanimes des entreprises et des élus locaux, au cours des auditions menées, "à avoir de la stabilité et de la prévisibilité dans les questions d’aménagement du territoire".
"Depuis trois ans les échéances ont été modifiées à deux reprises, les assouplissements se sont succédé, chaque nouvelle réforme a repoussé un peu plus la lisibilité du cadre juridique. Il est temps de consolider l’édifice, les élus ont engagé de lourds travaux de révision de leurs documents d’urbanisme, ils ont entamé dans le dialogue la territorialisation des objectifs, ils ont besoin de visibilité et c’est la raison pour laquelle un troisième report des échéances serait un recul vis à vis de leur engagement", a martelé Sandrine Le Feur.
Report à 2034 du jalon intermédiaire
Les corapporteures affichent toutefois "un léger désaccord" sur l’objectif intermédiaire de moins 50% de consommation foncière d’ici 2031 actuellement en vigueur. "Si nous partageons les mêmes objectifs de sobriété foncière, je suis d’avis que leur appropriation effective par les territoires nécessite aujourd’hui davantage de temps, c’est pourquoi je préconise le report de l’échéance intermédiaire à 2034", a précisé Constance de Pélichy, tout en restant "convaincue qu’il faut un objectif". "Ce report permettrait selon les estimations du gouvernement de dégager une capacité de consommation supplémentaire d’environ 37.500 ha au bénéfice des territoires. Il s’agit de reconnaître une réalité, les années 2021 à 2023 déjà échues ne peuvent plus faire l’objet d’une action corrective de la part des collectivités territoriales, leur exclusion du calcul offrirait un levier de respiration indispensable", a-t-elle souligné.
Dans le rapport figure également la pérennisation de la mesure de l'artificialisation par le décompte de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf), au-delà de 2031 - une disposition également prévue par la proposition de loi Trace -, et plus précisément jusqu’en 2044, de façon à laisser du temps au Cerema de développer un outil efficace.
Le bâton…
Mais le coeur des propositions repose sur un principe simple : "donner aux élus des outils pour agir", à commencer par la fiscalité. La question préoccupe également le Sénat depuis un certain temps puisque dès juin 2022 un rapport de contrôle budgétaire réalisé par Jean-Baptiste Blanc (LR, Vaucluse) - l’un des co-auteurs de la PPL Trace - préconisait une remise à plat de la fiscalité locale pour atteindre les objectifs de réduction progressive de l'artificialisation des sols fixés par la loi Climat et Résilience. Et qu’une autre mission - dont le sénateur Jean‑Baptiste Blanc est à nouveau l’un des rapporteurs - doit aussi s’atteler à proposer le modèle financier nécessaire à la mise en œuvre du ZAN.
"Il est incohérent de fixer un objectif de sobriété foncière tout en maintenant des positions fiscales qui encouragent l’artificialisation", a remarqué Sandrine Le Feur. Le rapport propose ainsi de supprimer diverses exonérations fiscales contraires à l’objectif de sobriété foncière : celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles, de la taxe d’aménagement pour les entrepôts, hangars, parkings couverts ou encore de manière partielle sur les premiers m2 d’une construction.
La mission envisage également de réformer en profondeur la taxe d’aménagement "en doublant le taux maximal de droit commun" et en permettant "un taux spécifique pour les secteurs urbanisés sur des espaces naturels, agricoles et forestiers". Autre proposition : généraliser la taxe sur les friches commerciales et industrielles et élargir la taxe sur les surfaces commerciales aux entrepôts logistiques et aires de stationnement avec "une modulation" selon leur localisation et leur emprise foncière.
"Ces outils fiscaux sont conçus pour être à la main des élus, ce sont eux qui auront la capacité de moduler les taux, de cibler les projets vertueux, de mobiliser les ressources au service de leur stratégie territoriale. Ce sont eux qui pourront dissuader, inciter et réorienter, c’est une fiscalité d’action publique locale au service d’un objectif collectif national", a expliqué la présidente de la commission.
… et la carotte
"Il s’agit non seulement de taxer les actions qui artificialisent mais aussi de valoriser les actions qui préservent les sols", a de son côté insisté la députée du Loiret. C’est pourquoi le rapport préconise des exonérations renforcées de taxe foncière pour les Enaf "pour revaloriser le rendement de ces actifs qui est aujourd’hui nettement inférieur à un espace urbanisé", l’exonération d’impôt sur le revenu des fermages perçus pour ces terres, une modernisation des taxes sur les plus-values foncières avec la suppression des exonérations pour durée de détention et une taxation renforcée en cas de spéculation excessive.
Le signal envoyé est clair : "préserver les sols c’est rendre un service environnemental essentiel à la collectivité, ce service doit être reconnu et soutenu, mais il faut aller plus loin, il faut aussi encourager la réutilisation de ce qui existe déjà, et cela passe par la réhabilitation de l’existant", a-t-elle développé. Le rapport prévoit la création d’un crédit d’impôt des dépenses engagées pour remettre sur le marché des logements vacants dans les territoires en tension. Parallèlement, la fusion des taxes sur les logements vacants assortie d’une majoration ciblée pour les multiples propriétaires de logements sous-utilisés doit permettre de lutter contre la rétention foncière.
Nouveaux outils pour les maires
Parmi les propositions : un droit de préemption spécifique sur la préservation des Enaf, la généralisation du sursis à statuer, un recours facilité à la procédure de bien sans maître pour mobiliser les logements abandonnés (pour les successions ouvertes depuis plus de dix ans) et des dérogations d’urbanisme élargies pour favoriser la "densification douce", notamment dans les zones rurales et les friches urbaines.
Un dernier volet concerne l’ingénierie. "Le ZAN ne peut réussir sans un accompagnement massif structuré et pérenne", a relevé Constance de Pélichy. Le rapport recommande la création d’un parcours d’accompagnement fondé sur trois piliers : des modules d’aide au diagnostic foncier, un chef de projet financé à l’échelle intercommunale dans les territoires ruraux et des conventions locales avec les acteurs d’ingénierie, comme les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), les agences d’urbanisme ou les établissements publics fonciers (EPF), avec pour ces derniers l’objectif d’une couverture totale du territoire. Cette offre pourrait être expérimentée "dès 2025", avant une généralisation en 2026, financée à moyens constants par le fonds vert.
Les corapporteures invitent l’Assemblée à se saisir de leurs propositions "le cas échéant, dans le cadre d’une proposition de loi". "L’outre-mer souvent à l’avant-poste des crises climatiques, économiques et sociales ne peut être tenu à la marge des politiques publiques d’aménagement du territoire, elle doit au contraire être au coeur de nos réflexions comme laboratoire des transitions mais aussi comme un miroir de nos contradictions", a souligné le président de la mission, Marcellin Nadeau, saluant entre autres les préconisations du rapport qui reconnaissent la nécessité d’un assouplissement spécifique pour la Guyane.


