Projet de loi Climat et Résilience : l’Assemblée étoffe les volets eau et forêt
Grande absente du projet de loi Climat et Résilience, la politique forestière en fait désormais partie intégrante, suite au passage du texte dans l’hémicycle, au sein des dispositions visant à protéger les écosystèmes et la diversité biologique, et au même titre que celles permettant d’assurer une gestion durable de l’eau et de ses usages.
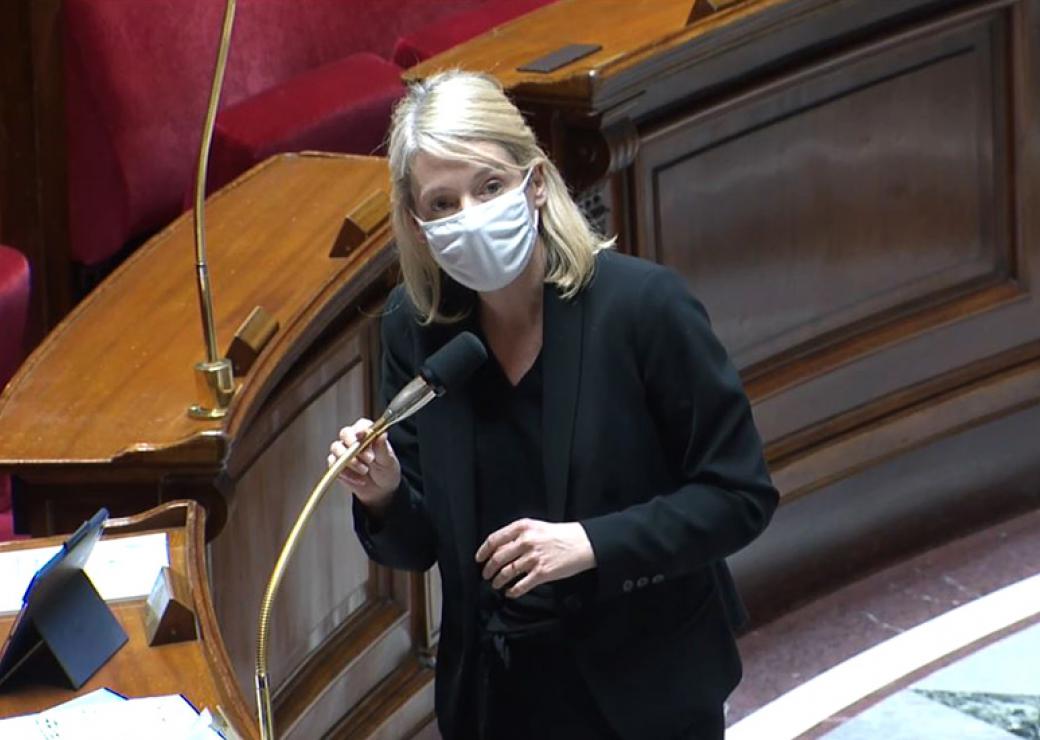
© Capture vidéo Assemblée nationale/ Bérangère Abba
Après s’être penchée sur le verdissement de la commande publique, et avant de s’attaquer à la réforme du code minier, l’Assemblée nationale a poursuivi, ce 7 avril, l’examen du titre II du projet de loi Climat et Résilience (lire aussi notre dossier), qui regroupe également sous l’intitulé "Produire et travailler" des dispositions axées sur la protection des écosystèmes, en particulier à travers la gestion équilibrée de l’eau. Les députés de tous bords y ont adjoint une série de mesures pour favoriser l'adaptation des forêts au dérèglement climatique. Cette problématique, qui a déjà fait l'objet de plusieurs rapports et d'une feuille de route dévoilée en décembre, était jusqu’ici la grande absente du projet de loi, malgré les propositions portées par la Convention citoyenne pour le climat sur le sujet. Le volet forestier du plan de relance sera, pour rappel, doté de 200 millions d'euros pour les deux prochaines années.
Adapter l’emploi à la transition écologique (chapitre II)
Formation à la sobriété numérique (article 18 bis A nouveau)
A l’initiative de la rapporteure du titre, Cendra Motin, un nouvel article inscrit la formation à la sobriété numérique dans les objectifs généraux de formation et d’orientation professionnelles tout au long de la vie, "à laquelle participent non seulement les chambres consulaires mais également tous les acteurs concernés : l’État, les collectivités territoriales, les organisations syndicales et professionnelles d’employeurs, les opérateurs de compétences, etc.", souligne-t-elle. L’article 18 bis introduit en commission spéciale, et dont le spectre était restreint aux seules chambres consulaires a donc été supprimé.
Accompagnement des salariés des centrales à charbon (article 18 ter nouveau)
Le texte ratifie l’ordonnance 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. Au passage, l’amendement du gouvernement y apporte quelques clarifications "apparues nécessaires pour ce qui concerne le volet portuaire". Il ouvre notamment "une possibilité, encadrée et adaptée aux spécificités des places portuaires, de cumul entre le congé et des périodes de travail".
Protéger les écosystèmes et la biodiversité (chapitre III)
Principes généraux en matière de protection de l’eau (article 19)
Face à la multitude des amendements visant, sinon à la suppression, à la réécriture de l’article 19, qui prévoit d’insérer à l’article L. 210-1 du code de l’environnement la protection des écosystèmes aquatiques parmi les grands principes généraux de l’eau, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili a mis les points sur les i : dans cet article "nous rappelons qu’il n’y a pas d’usage de l’eau sans écosystèmes préservés et fonctionnels. Rien ne modifie la manière dont la répartition de la ressource doit se faire".
La rapporteure a proposé de rappeler explicitement que les zones humides sont des parties du grand ensemble des écosystèmes aquatiques.
Qualité de l’eau comme patrimoine de la nation (article 19 bis A nouveau)
Le texte défendu par Frédérique Tuffnell (Modem) - à l’origine d’un rapport sur les conflits d’usage en situation de pénurie - cite explicitement la qualité de l’eau comme faisant partie du patrimoine commun de la nation, au même titre que la qualité de l’air, au sein de l’énumération de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Restauration des zones humides (article 19 bis B nouveau)
L’objet de ce nouvel article, également porté par Frédérique Tuffnell, est d’intégrer la restauration des milieux aquatiques, notamment celle des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins, à l’énoncé des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit prendre en compte, au titre des services écosystémiques d’importance significative qu’ils rendent, tels que la séquestration de carbone.
Fin des financements pour la destruction des moulins à eau (article 19 bis C nouveau)
Au terme d’un débat acharné, l’Assemblée a adopté - contre l'avis du gouvernement et de la rapporteure - pas moins de 29 amendements similaires (dont la moitié LR) pour faire barrage au financement de la destruction de retenues de moulins à eau, dans le cadre des obligations de franchissement des poissons et du transport de sédiments. De nombreux députés de tous bords, y compris dans les rangs de la majorité, sont montés au créneau pour défendre les moulins de leur circonscription. Un serpent de mer abordé en dernier lieu dans la proposition de loi LR tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique, adoptée en commission au Sénat, le 31 mars dernier.
"Les seuils des moulins sont devenus l’ennemi public numéro un de la direction de l’eau et de la biodiversité", a relevé Jean-Marie Sermier (LR), déplorant les "pressions" exercées sur le terrain "pour inciter les propriétaires de moulins à réduire, voire à supprimer les seuils". "Alors que notre territoire est soumis à un manque d’eau de plus en plus prégnant, des centaines de retenues d’eau sont détruites chaque année sur fonds publics dans le cadre de politiques dites de ‘continuité écologique’", s’est également indignée la députée Stéphanie Kerbarh (LREM), épinglant "une doctrine radicale ne faisant l’objet d’aucun consensus scientifique et participant à la destruction d’un patrimoine ancien".
Un débat qui n’a pas manqué d’agacer la ministre : "Personne n’a envie de tuer les moulins. Il faudrait avoir enfin une démarche apaisée : le sujet suscite une passion quelque peu excessive, disproportionnée". Et de corriger : "L’État n’a pas sur le sujet de position dogmatique de méthode privilégiée par principe. Les agences de l’eau - heureusement que nous les avons, quoi qu’en pensent ceux qui les attaquent - financent les seuils, les effacements, les passes à poissons mais en appliquant les prescriptions du préfet". Enfin, les chiffres sont là : seulement 11% des cours d’eau et moins de 3% des seuils de moulins sont concernés. Dans deux tiers des cas, la solution ne consistera d’ailleurs pas à détruire le seuil, mais à prévoir des passes à poissons.
Une position corroborée par Frédérique Tuffnell : la politique de restauration des cours d’eau "ne vise pas à détruire des moulins, la plupart des ouvrages qui se trouvent dans les lits mineurs ne sont pas des moulins. Il s’agit là d’une généralisation visant à nous laisser croire que l’on fait n’importe quoi, ce qui est absolument faux. Demandez aux agences de l’eau : elles ne font pas n’importe quoi !". "S’il vous plaît, chers collègues, ne chargez pas les agences de l’eau : dans cette affaire, elles sont celles qui financent, mais pas celles qui donnent l’ordre. En outre, la majorité des seuils sont aujourd’hui équipés plutôt qu’effacés", a renchéri le député LR Martial Saddier, fraichement réélu président du comité de bassin Rhône-Méditerranée et spécialiste reconnu de ces questions, avant d’indiquer qu’il ne voterai pas ces amendements "qui auraient pour conséquence de mettre fin au financement par les agences de l’eau de tous les équipements de seuils". "Vous y gagneriez peut-être à court terme, en termes de suppressions de seuils, mais les comités de bassin et les agences de l’eau se retireraient. Or, avec les propriétaires, nous avons besoin de leurs financements pour amorcer la pompe et obtenir le concours des collectivités territoriales, des départements et des régions", a -t-il développé.
Révision des principes de la gestion forestière (article 19 D nouveau)
Le texte s’est par ailleurs enrichi d’un volet sur la politique forestière, pour l'orienter vers une sylviculture plus respectueuse des cycles naturels, maintenant un couvert forestier continu et une diversité d’essences, afin d’améliorer le stockage du carbone par les sols et la capacité de résilience des forêts aux impacts des changements climatiques. L'Etat y veille "en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens", ajoute le texte. Enfin, un lien de conformité y est établi entre la rédaction du programme national de la forêt et du bois et l’ensemble des objectifs formulés. Cette mesure propulsée par 14 amendements identiques de la majorité et de l’opposition (de LR à LFI et non-inscrits) est largement inspirée du cahier de propositions de l’association Canopée et fait écho à tout un pan des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, jusqu'ici non repris. Plusieurs sous-amendements de la rapporteure y ont toutefois apporté toute une série d’ajustements de façon à relier le rôle de puits de carbone au stockage dans les bois et forêts et au bois matériau, affirmer la contribution à l’objectif de neutralité carbone l’horizon 2050, mentionner le recours à la migration assistée des essences, ou encore substituer le terme bois d’œuvre - plus communément utilisé dans la RE2020 - à celui de bois massif. "L’enrésinement pose des problèmes localement, mais il semble important de ne pas exclure de manière générale les parcelles en résineux", s’en est expliquée la rapporteure. Cendra Motin a mis un dernier coup de rabot aux ambitions du texte : "les aides publiques pour les forêts sont déjà conditionnées par l’application de documents de gestion et il ne me semble ni souhaitable ni utile de subordonner leur octroi à des résultats". Le gouvernement a également tenu à revenir - par deux sous-amendements - sur l’application stricte de la diversification des essences à l’échelle de la parcelle et à supprimer la notion du bon état de conservation des forêts "qui pourrait poser question s’agissant des coupes qui sont parfois nécessaires à la fourniture de bois", au grand dam de Mathilde Panot (LFI).
Stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique (article 19 bis E nouveau)
L’État devra se doter d’une stratégie nationale spécifique pour adapter la forêt au dérèglement climatique, d’ici à fin 2022. Cette proposition des députés du groupe LR n’a pas emporté la conviction du gouvernement et de la rapporteure. Il existe déjà beaucoup de documents de référence et l’établissement d’une nouvelle feuille de route "n’est pas nécessaire", a estimé la secrétaire d’Etat à la Biodiversité, Bérangère Abba.
Adapter le programme national de la forêt et du bois (article 19 bis F nouveau)
Il s’agit aussi d’adapter le programme national de la forêt et du bois décliné dans les régions, et ce dès 2022, c’est-à-dire après l’évaluation à la mi-parcours du programme 2016-2026, en prenant en compte les recommandations de la feuille de route des professionnels pour l’adoption des forêts au changement climatique et les données de l'inventaire forestier national. "Le défi des trente prochaines années sera de reconstituer, adapter ou boiser une surface équivalente à environ 20.000 fois la surface du stade de France (…). Au-delà des régénérations naturelles, il faudra replanter 70 millions d’arbres par an pendant trente ans pour maintenir notre capital forestier. Ce n’était pas prévu en 2016, quand nos prédécesseurs et Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, avaient élaboré le programme national de la forêt et du bois, qui doit durer jusqu’en 2026", a relevé, la députée du Nord Anne-Laure Cattelot (LREM), auteure du récent rapport sur la forêt et la filière bois, pour défendre l'amendement. Un travail unanimement salué par les députés et la secrétaire d’Etat, qui a toutefois jugé "qu’il n’était pas utile, à ce stade, d’inscrire un tel cadre d’évaluation dans la loi".
Obligation de produire un diagnostic et un programme d’actions pour améliorer les réseaux d’eau (article 19 bis G nouveau)
Le texte ajoute au descriptif des ouvrages et équipements nécessaires à la production, au transport et à la distribution d’eau potable, l’obligation pour les collectivités de produire un diagnostic et un programme d’actions tenant compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles, voire un projet pluriannuel de travaux pour améliorer les réseaux, au terme d’amendements Modem et LREM, sous-amendés par la rapporteure. L’échéance prévue pour la réalisation de ces documents est fixée au 31 décembre 2024 ou dans les deux années qui suivent la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes si elle intervient après le 1er janvier 2023.
Reconnaissance de la richesse biologique des outre-mer (article 19 bis H nouveau)
Contre l'avis de la rapporteure et du gouvernement, l'Assemblée a également adopté un amendement du député PS de la Martinique, Serge Letchimy, pour inscrire dans la loi "la place prépondérante des territoires d’outre-mer dans la richesse biologique et environnementale française, en assurant sa reconnaissance, son évaluation, sa préservation et sa mise en valeur".
Renforcer la protection des ressources en eau souterraine stratégiques (article 19 bis)
Un amendement co-signé par la rapporteure et le député LR Martial Saddier réécrit largement cet article introduit en commission spéciale à l’initiative de ce dernier et d'ailleurs issu de sa proposition de loi. Cette disposition permettra d’identifier - au plus tard fin 2027 - les masses d’eau souterraines ou aquifères dont la ressource est stratégique pour l’alimentation en eau potable future et les zones de sauvegardes concernées, et de prévoir, dans les modalités de concertation habituelle des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage), les mesures pertinentes pour les préserver. "De cette manière, les nappes stratégiques seront parties intégrantes des Sdage relatifs à la période 2028-2033 et seront répertoriées dans les Sage, c’est-à-dire au niveau local", s'est félicité Martial Saddier. Son amendement adopté en commission était plus ambitieux en ce qu’il tendait à ce que les PLU (plan locaux d’urbanisme) et Scot (schémas de cohérence territoriale) intègrent les enjeux relatifs à l’eau potable. "Je conçois qu’il s’agissait là d’un pas de géant et c’est pourquoi le présent amendement opte, en accord avec Mme la rapporteure, pour un progrès plus mesuré en ne ciblant que les Sdage et les Sage", a-t-il convenu. "Nous avons entendu les inquiétudes de certains qui estiment – hélas encore – qu’un renforcement de la législation relative à l’eau s’effectuerait à leur détriment. (…) c’est pourquoi nous prévoyons que, dans le cadre des Sage, les élus pourront prendre des mesures pour accompagner l’adaptation des activités humaines dans les zones de sauvegarde", a concédé de son côté Cendra Motin.


