Une décennie d’évaluation environnementale : des progrès et des lacunes
Dans le bilan qu’elle tire de ses dix premières années d’existence, l’Autorité environnementale relève une amélioration de la qualité des dossiers qui lui sont soumis mais aussi "une incompréhension de la valeur ajoutée de l’évaluation environnementale" dans les dossiers concernant les infrastructures routières, les plans régionaux et l’indifférence des maîtres d’ouvrage de projets vis-à-vis du changement climatique et de la qualité de l’air.
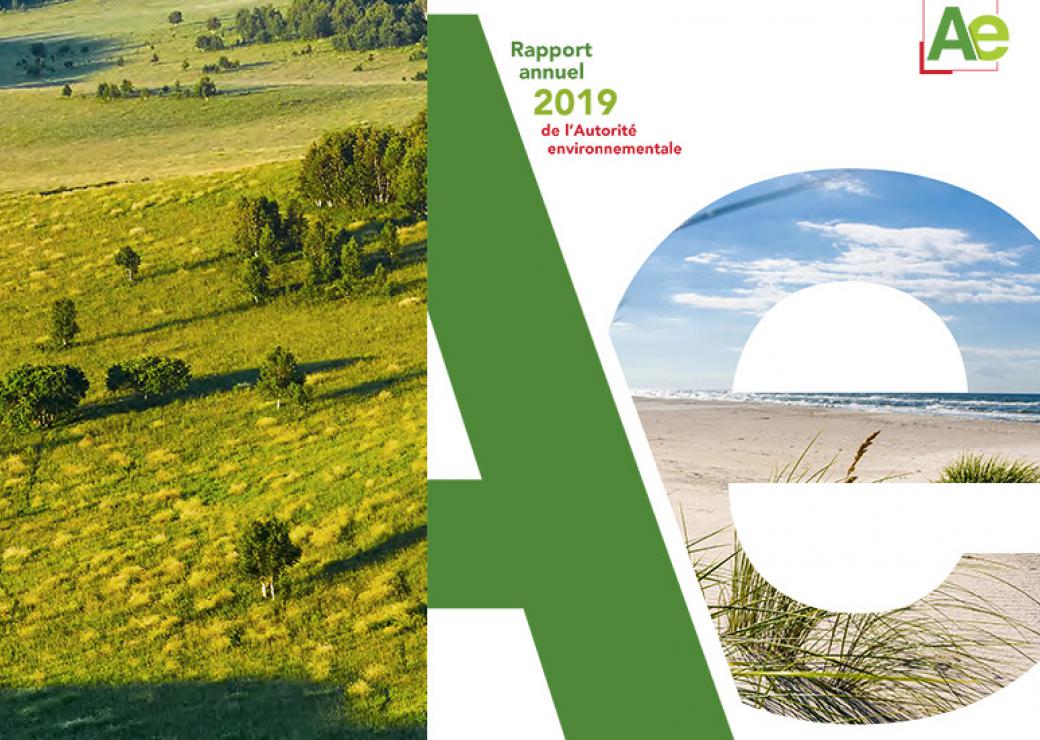
© developpement-durable.gouv.fr
L’Autorité environnementale (Ae) a publié le 31 mars le bilan de l’année d’activité 2019. Elle fête à cette occasion ses dix années d’existence et le palier atteint d’un millier d’avis donnés durant cette décennie, soit un rythme d’une centaine d’avis par an (un peu plus en 2019, 123 avis). Si la qualité des dossiers progresse, les lacunes qu’elle pointe se concentrent dans ceux relatifs aux infrastructures routières (faiblesse des études de trafic) et aux plans régionaux qui, "sauf rares exceptions, peinent à démontrer une prise en compte suffisante de toutes les composantes de l’environnement, quand ils ne reposent pas sur une vision et des données dépassées (pour de nombreux projets routiers initiés de longue date)".
Une indifférence persistante
Le diagnostic sur lequel devraient reposer les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) néglige, selon elle, la portée de l’évaluation environnementale reléguée au rang d’exercice un peu "vain, faute d’une méthode pertinente". Elle relève aussi "l’indifférence des maîtres d’ouvrage des projets vis-à-vis du changement climatique et de la qualité de l’air, en dépit des alertes et des rappels insistants du public, de la communauté scientifique nationale et internationale, des principales institutions de la République et de la Commission européenne". Une situation qu’elle estime plus particulie?rement "préoccupante" pour des projets "structurants qui s’inscrivent à un horizon pour lequel la neutralité carbone devra être atteinte".
Le zéro artificialisation nette, cet horizon peu concret
Un coup d’oeil dans le rétroviseur des avis émis, tant sur de modestes projets de ZAC que sur celui, d’une "ampleur exceptionnelle" (accueil de 1.200 habitants supplémentaires, grandes emprises naturelles concernées) de pôle re?sidentiel à dominante golfique dans les Landes, montre que l’artificialisation des sols reste au centre des enjeux. En règle générale, l’Ae trouve que les mesures de compensation des pertes de biodiversité restent privilégiées par rapport aux solutions d’évitement et de réduction des impacts. Et quand il y a compensation, c’est "très en deçà des destructions occasionnées, faute de prendre en compte une approche écosystémique et de considérer les fonctionnalités liées à la biomasse et à la capacité de stockage du carbone". Les objectifs zéro artificialisation nette et zéro perte nette de biodiversité restent donc à ses yeux des horizons nébuleux.
Développement aérien : quelle compatibilité avec les engagements environnementaux ?
Les dossiers aéroportuaires dont l’Ae a été saisie pour la première fois l’an dernier, notamment pour éclairer la Commission nationale du dé?bat public, font l’objet d’un focus éclairant. Ces projets concernant de grandes plateformes (terminal T4 à Roissy, extension du terminal 1 de Marseille-Provence) sont à multiples facettes, ont du mal à rentrer dans des périmètres aisés d’évaluation, ce qui rend difficile la mesure des effets du projet dans des domaines comme l’eau ou la biodiversité qui "ne prennent généralement tout leur sens qu'à l'échelle de la plateforme". Il n’empêche, elle constate que les plans de gestion du bruit et plans de gêne sonore, ouvrant droit à des aides pour des travaux d’insonorisation, ne sont pas forcément à jour voire finalisés, et que l’exposition des populations au bruit est rarement prise en compte dans sa globalité.
Dans ces dossiers porteurs d’augmentations de trafic, les émissions de gaz à effet de serre (GES) directes (opérations au sol, atterrissage-décollage) sont généralement évaluées. Mais l’approche reste "conventionnelle". Appliquée aux rejets de polluants atmosphériques, qui sont "susceptibles de présenter des incidences sanitaires locales", elle "n’a aucun sens pour les émissions de GES dont les effets sont globalisés dans l’atmosphère". Quant aux émissions liées aux constructions et matériaux, elles ne sont tout simplement pas fournies. Les effets indirects des extensions aéroportuaires envisagées ne sont pas mieux pris en compte. L’Ae estime ainsi indispensable de mettre à l’agenda "la question de la compatibilité du développement du trafic aérien avec les engagements environnementaux de la France dans les dossiers aéroportuaires qui seront présentés en 2020".
Continuer à consulter le public
C’est une nécessité pour l’Ae, qui invite à mieux prendre les avis du public en considération. Or elle constate que "de nombreuses dispositions, adoptées ou en cours d’examen par le législateur et l’exécutif, réduiront significativement le champ de sa participation, ce qui constitue à tout le moins une régression démocratique". Pour 2020, elle fonde l’espoir que plus de deux ans après la décision du Conseil d’E?tat confirmant que les préfets de région ne doivent pas assurer de fonction d’autorité environnementale, "des textes soient adoptés pour mettre fin à une pe?riode transitoire trop longue".


