Transition écologique : des pairs et des maires plutôt que des experts pour dépasser les tensions
Lors de rencontres de la transition écologique dans les territoires organisées ce 13 juin en distanciel par la communauté Comète animée par le ministère de la Transition écologique, la question du "dépassement des tensions" a beaucoup concentré l’attention. Pour les intervenants, ce dernier ne pourra se faire qu’à l’échelon local, grâce à la force de conviction des pairs plutôt que des experts, en réinventant des espaces de dialogue et d’écoute, en associant activement les citoyens pour "faire village" ou encore en leur apportant une "démonstration par l’exemple".
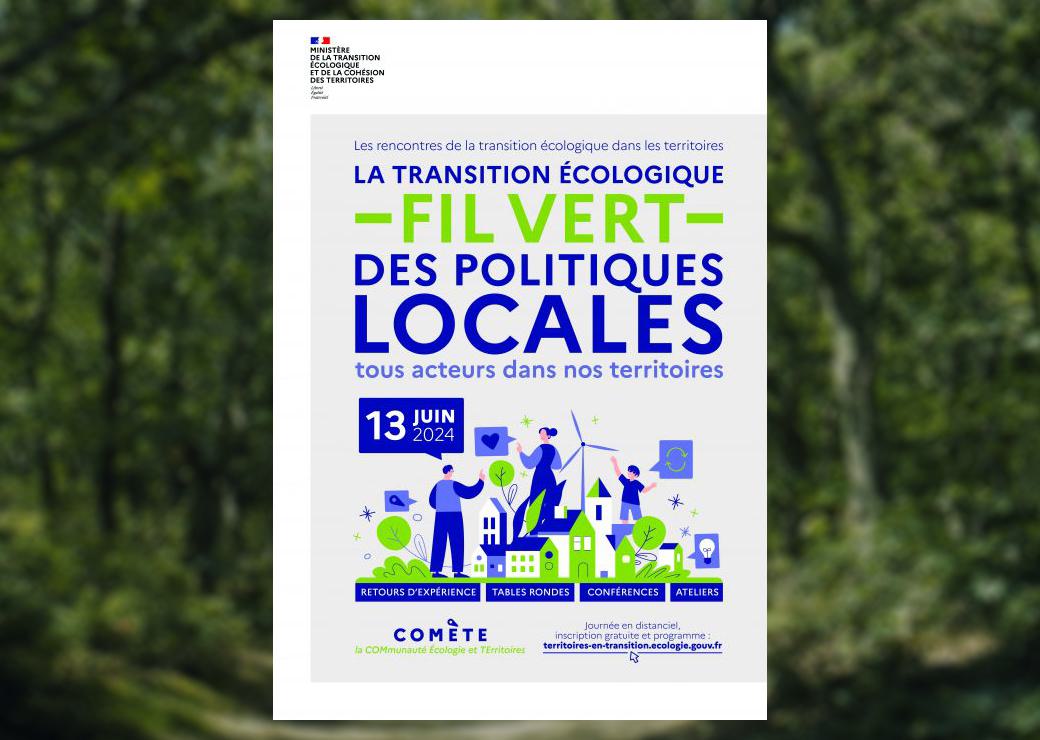
© Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et PxHere
Transition écologique : comment dépasser les tensions locales ? Tel était le thème de la séance d’ouverture – et en partie le fil rouge – des rencontres en distanciel organisées ce 13 juin par Comète, "la communauté écologie et territoires" animée par le ministère de la Transition écologique. Point n’est besoin de s’étendre sur le constat : la transition écologique suscite de fortes tensions… y compris chez ses partisans. "La population est assez sensible à la question de la transition écologique quand vous l'interrogez de manière générale. Après, quand vous rentrez dans le concret, ce qui est vraiment la réalité des maires, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué", observe Fanny Lacroix, maire de Châtel-en-Trièves et vice-présidente de l’Association des maires ruraux de France (AMRF), victime de "l’effet Napi". Et de déplorer ainsi l’échec, après deux ans de débats, d’un projet d’installation de parc éolien sur sa commune et ce, alors que "la mairie allait être propriétaire du foncier" et que le projet avait "des retombées économiques locales", assure-t-elle.
Une coopération centrale
"La transition, c’est une transformation sociale, et pas seulement des enjeux techniques et financiers. [Elle] transforme concrètement nos pratiques sociales, nos modes de consommation, nos modes de vie", souligne le sociologue Samuel Aubin. Pas étonnant qu’elle suscite des frottements. Pour lui, elle appelle en conséquence une "démarche systémique, une démarche dans laquelle aucun acteur n’a, à lui tout seul, l’ensemble des leviers pour porter ces transformations". Ce qui fait que "la question de la coopération est centrale", insiste-t-il, et nécessite "la mobilisation de l’ensemble de la société dans sa diversité". La transition ne pourra être conduite par une seule avant-garde éclairée, rappelait-on récemment du côté du CNFPT (voir notre article du 20 mars).
Complexité
Pour Fanny Lacroix, la mobilisation du plus grand nombre est d’autant moins aisée "qu’on a souvent tendance à apporter beaucoup de complexité, éminemment technique, qui s’inscrit dans notre manière de construire les politiques publiques, et avec laquelle, malheureusement, on perd beaucoup d’élus et de citoyens". Benoit Dufumier, directeur départemental des territoires et de la mer en Côtes d’Armor, estime, lui, que "la complexité, qui crée des tensions, est au cœur de cette transformation". Il souligne que sa gestion constitue d’ailleurs également "un défi interne pour les collectivités et l’État. Nous sommes obligés de globaliser les raisonnements, de travailler à plusieurs, d’anticiper ces complexités, et donc les équipes doivent se former, et peut-être même s’organiser différemment, avec plus de travail en commun, plus de transversalité".
Des pairs et des maires
Reste qu’à tout le moins, il faut surveiller son langage. "Pour s’écouter, il faut déjà comprendre ce que dit l’autre. C’est la difficulté d’être toujours dans l’entre-soi, avec un vocabulaire hermétique", appuie Danielle Mametz, présidente du syndicat mixte Flandre et Lys et maire de Boëseghem. Le vocabulaire, mais aussi le registre du discours. Fanny Lacroix estime en effet que si "l’expertise scientifique est absolument essentielle", il est "difficile de porter une parole scientifique à une population qui éprouve le sentiment d’être laissée pour compte" et qui se détourne en conséquence des institutions, politiques ou scientifiques. Pour l’élue, si "la figure du maire" reste encore "absolument essentielle, plus on va s’éloigner, et plus il va y avoir une remise en question". Convaincue que "ce sont les proches qui vont avoir de l’influence sur ces populations", elle plaide pour "faire parler des pairs, des gens qui vivent les conséquences que les transitions produisent sur les territoires", évoquant l’agriculteur ou le forestier.
Jean-Pierre Seyvos, fondateur, co-directeur artistique de S-composition, en est également convaincu : "L’approche un peu descendante, avec une expertise un peu lointaine, ne marche plus". Samuel Aubin opine, invoquant la logique du ressentiment mise en lumière par la philosophe Cynthia Fleury : "Dans un système social assez stable, on aurait l’idée qu’il s’agirait de développer un dialogue rationnel, que cela se jouerait du côté de la qualité des arguments. Or à un moment donné d’une crise sociale et politique profonde, la dimension des affects devient très importante et peut même prendre le dessus".
La preuve par l’exemple
Pour Nathalie Regond Planas, présidente du Pays Pyrénées-Méditerranée, c’est "par la démonstration que l’on finit par convaincre". La preuve par l’exemple. Un exemple qui doit également s’entendre comme "être exemplaire", souligne Danielle Mametz : "Pour obtenir l’adhésion, il faut faire ce qu’on dit, et dire ce qu’on fait. Il faut être cohérent". Elle aussi insiste sur l’importance "d’illustrer les orientations retenues par des réalisations sur le territoire", en "zoomant sur un projet et dézoomant pour montrer comment il s’inscrit dans un projet beaucoup plus global". Mais pour elle, "la première chose à faire, avant de parler de chiffres, avant de parler de règles, c’est d’instaurer des espaces de dialogue et d’écoute".
Dialoguer, mais comment ?
Des espaces qui, selon Nathalie Regond Planas, doivent néanmoins être "réinventés" : "Une réunion publique, cela n’apporte strictement rien. On ne fait que mettre des positions en opposition". Pour elle, "il faut vraiment être dans l’informel pour que cela infuse, dans les réunions de quartier, les repas de quartier. Ça prend du temps". Pour Jean-Pierre Seyvos, tout est question de méthode. Il confesse qu’au démarrage des projets qu’il a pu conduire, "l'écoute mutuelle est extrêmement complexe. On est envahi par des opinions complètement contradictoires, il y a une grande difficulté à s'écouter". Mais il souligne que "permettre de donner la parole à chacun, de pouvoir s’exprimer et d’être entendu, c’est jouer d’une façon plus horizontale". Il met en avant différentes méthodologies qui permettent de créer une meilleure compréhension mutuelle, de faire émerger si ce n’est un consensus, de nouvelles propositions, de "nouvelles diplomaties", ou de permettre qu’une décision politique soit mieux comprise, comme les démarches "Où atterrir ?" et "cartographie des controverses" promues par Bruno Latour. En ajoutant qu’il faut aussi "pouvoir accompagner certaines personnes dans l'expression de ce qu'elles ont à dire, ce qui n'est pas forcément évident pour certaines d'entre elles".
Il y a majorité silencieuse et majorité silencieuse
Pour Nathalie Regond Planas, il est aussi "important, en tant qu’élu local, de ne pas céder à certaines voix qui sont minoritaires", "souvent beaucoup plus sonores que la majorité silencieuse". Elle insiste : "La somme des individualités ne fait pas le collectif. Il ne faut pas essayer de répondre à des cas par cas qui, de toute façon, seraient complètement en opposition les uns aux autres". Samuel Aubin se fait plus tempéré, jugeant qu’il faut considérer cette notion de majorité silencieuse avec précaution : "Il y a eu une époque où on pouvait considérer que cette majorité silencieuse ne s'exprimait pas parce qu'elle avait confiance dans le fonctionnement de notre système de représentation. Je ne suis pas sûr que nous soyons aujourd'hui dans la même situation, que la majorité silencieuse soit silencieuse pour la même raison", alerte-t-il avec un art consommé de la litote.
Nécessaire passage à l’acte
Danielle Mametz vante ainsi le "besoin de proposer des initiatives pour embarquer les gens, d’associer les habitants sur le projet de territoire et qu’ils en soient acteurs", comme le suggérait récemment François Gemenne (voir notre article du 29 mai). En l’espèce, Fanny Lacroix prend toutefois le soin de distinguer "deux formes de participation des habitants". Si elle ne sous-estime pas les mérites des stratégies "où l’on va chercher l'expertise des habitants pour construire une politique publique, pour construire un document de planification qui soit adapté", elle insiste sur le fait qu’on "a aussi besoin d’autres stratégies de démocratie participative qui créent un effet de masse, pas un dispositif qui emmène 20 personnes dans une réunion publique. Au-delà de faire des balades urbaines, la question c’est comment fait-on village ensemble. Comment un village peut, au quotidien, être envisagé comme un commun, comme on le faisait par le passé. C’est comment je prends ma pelle et ma pioche pour aller entretenir le ruisseau, les sentiers. Il faut cultiver la citoyenneté active dans les actes de tous les jours, et ça, cela se fait au plus près, donc à l’échelle de la commune".


